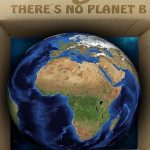Présentation
RÉSUMÉ
Dans le dossier d’autorisation d’exploiter, le futur exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement doit présenter une analyse de dangers, ainsi que les mesures propres à réduire la probabilité de survenue des accidents. Cet article est consacré à l’analyse et à l’étude des impacts possibles des accidents répertoriés. Dans cet objectif, quatre scénarios sont détaillés pour aider à l’évaluation des conséquences pour l’homme et l’environnement : incendie, explosion non confinée de gaz ou de vapeurs, explosion accompagnée d’une boule de feu, et dispersion de gaz toxiques.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleABSTRACT
Auteur(s)
-
Jean-Louis SEVEQUE : Docteur en géochimie - Consultant - Expert judicaire près la cour d’appel d’Amiens
INTRODUCTION
Comme pour l’étude d’impact, le contenu de l’étude de dangers est défini dans le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement codifiée article L. 511-1 et suivants du Code de l’environnement et, plus spécifiquement, dans son article 3, paragraphe 5. Il est ainsi stipulé qu’à chaque exemplaire de la demande d’autorisation doit être jointe une étude de dangers qui :
-
d’une part expose les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident, en présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel ;
-
d’autre part justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur.
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à la connaissance du demandeur, la nature et l’organisation des moyens de secours privés dont le futur exploitant dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.
Nous avons présenté, dans un dossier précédent Étude de dangers des ICPE- Identification des dangers « Étude de dangers des ICPE. Identification des dangers », l’analyse des installations existantes ou à venir sur un site (dangers intrinsèques) ou des dangers externes au site mais pouvant entraîner l’apparition d’un danger sur le site.
Dans ce deuxième dossier Étude de dangers des ICPE- Analyse des scénarios « Étude de dangers des ICPE. Analyse des scénarios », nous décrirons l’analyse et l’étude des impacts possibles des accidents.
Selon la loi codifiée du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, l’exploitant d’une installation classée doit démontrer que son activité n’engendre aucune conséquence fâcheuse pour l’environnement et l’homme ; sont ici visés les risques d’accidents et de pollutions accidentelles. Il lui appartient de décrire ces risques et leurs conséquences, les mesures prises pour les prévenir et le niveau de risque résiduel.
Il s’agit donc de calculer les conséquences des agressions dont une unité industrielle peut être le siège. Cette agression porte sur le voisinage de l’unité.
Les récepteurs à envisager sont de deux types :
-
en tout premier lieu, le corps humain ;
-
en second lieu, les équipements voisins de l’équipement « agresseur ». Les équipements ne nous intéressent pas nécessairement en tant que tels, mais parce qu’ils peuvent contribuer, par synergie d’incidents, à modifier l’incident initial, en l’aggravant ou en le compliquant, en modifiant les conditions et les modalités d’intervention...
D’où la question : de quelle façon peut-on être blessé ou, éventuellement, tué ?
-
par brûlure ;
-
par asphyxie ;
-
par intoxication ;
-
soumis à une onde de choc ;
-
frappé par un « missile ».
Les phénomènes accidentels envisagés sont essentiellement :
-
l’incendie ;
-
l’explosion de type UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) ou explosion « non confinée de gaz ou de vapeurs » ;
-
l’explosion sous forme de BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), explosion accompagnée d’une « boule de feu » si le gaz liquéfié est inflammable ;
-
la dispersion de gaz toxiques.
DOI (Digital Object Identifier)
Cet article fait partie de l’offre
Environnement
(501 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
Cet article fait partie de l’offre
Environnement
(501 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - LANNOY (A.) - Analyse des explosions air-hydrocarbure en milieu libre. Études déterministe et probabiliste du scénario d’accident — Prévision des effets de surpression - . Bulletin de la direction des études et recherches, Électricité de France, no 4, série A (oct. 1984).
-
(2) - TNO - Methods for the calculation of physical effects — "Yellow Book" - . Committee for the Prevention of Disasters CPR 14E (Part 2) 3e édition (1997).
-
(3) - VAN DEN BERG (A.C.) - The Multi-energy method — a framework for vapour cloud explosion blast prediction - . TNO Prins Maurits Laboratory, report PML (1984-C72).
-
(4) - KINSELLA (K.G.) - A rapid assessment methodology for the prediction of vapour cloud explosions - . Research report no 357, Technical Research Centre of Finland (1993).
-
(5) - INERIS - Guide des méthodes d’évaluation des effets d’une explosion de gaz à l’air libre - . Direction des Risques Accidentels — Unité thématique Phénoménologie (juill. 1999).
- ...
Cet article fait partie de l’offre
Environnement
(501 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive