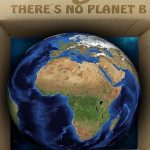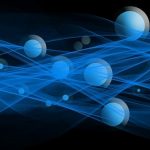Présentation
Auteur(s)
-
Yves BRUNET : Professeur à l’Institut National Polytechnique de Grenoble - CNRS - Centre de Recherches sur les très basses températures (CRTBT)
-
Jean-Louis SABRIÉ : GEC-Alsthom-Belfort
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleINTRODUCTION
1. Contraintes cryogéniques
1.1 Propriétés des matériaux à basse température
1.1.1 Propriétés mécaniques
1.1.2 Propriétés thermiques
1.1.3 Critère thermomécanique
1.1.4 Propriétés électromagnétiques et diélectriques
1.2 Contraintes propres aux supraconducteurs
1.2.1 Aimants à courant continu
1.2.2 Inducteurs tournants
1.2.3 Enroulements supraconducteurs à courant alternatif
1.3 Cryogénie
2. Aimants de recherche et aimants industriels
2.1 Dispositifs pour accélérateurs de particules
2.2 Solénoïdes pour détecteurs de particules
2.3 Hauts champs magnétiques
2.4 Utilisation des sources primaires d’énergie
2.5 Applications médicales
2.6 Séparation magnétique
2.7 Autres utilisations
3. Applications électrotechniques
3.1 Généralités
3.2 Moteurs et générateurs
3.2.1 Machines homopolaires
3.2.2 Cryoalternateurs. Moteurs synchrones
3.2.3 Structures originales
3.3 Composants statiques
3.3.1 Transformateurs
3.3.2 Limiteurs
3.3.3 Stockage. Régulation
3.4 Systèmes impulsionnels
4. Transports
4.1 Lévitation
4.2 Propulsion MHD
5. Autres utilisations
5.1 Applications à l’espace
5.2 Écrans magnétiques
5.3 Applications diverses
6. Impact des céramiques supraconductrices (HTSC)
7. Conditions d’industrialisation
Références bibliographiques
Pour en savoir plus
Le lecteur pourra utilement se reporter, dans ce traité, à l’article 02 700 Supraconducteur et, dans le traité Génie énergétique, aux articles Cryogénie.
Les premières applications de la supraconductivité, les aimants supraconducteurs pour laboratoires, se sont développées dans les années 1960, alors que le phénomène avait été découvert en 1911 ; ce n’est que dans les années 1980 qu’est apparu le premier marché industriel de série, celui des aimants pour imagerie par résonance magnétique.
Bien que les propriétés des matériaux supraconducteurs soient remarquables (densité de courant, champ magnétique, pertes), voire sans concurrence de la part des techniques établies [transition résistive N-SC (cf. D 2 700 § 4,113), possibilités de créer des champs magnétiques de plusieurs teslas, quantification du flux magnétique…], et qu’elles induisent des avantages indéniables (rendement, puissances massiques et volumiques), le transfert technologique vers l’industrie n’a pas encore abouti malgré le développement de nombreuses machines cryoélectriques dans les laboratoires. D’une part, les contraintes cryogéniques importantes, liées à l’emploi d’hélium liquide (4,2 K) pour les supraconducteurs à basse température, d’autre part, les excellentes performances des matériaux classiques rendent difficile l’émergence de ces matériaux dans les applications industrielles.
Ni la mise au point de conducteurs supraconducteurs utilisables aux fréquences industrielles, ni la découverte en 1987 de supraconducteurs à température critique supérieure à 77 K n’ont encore modifié cette situation, ces derniers matériaux restant pour l’instant peu commodes d’emploi et n’ayant pas encore atteint, pour des tailles et dans des conditions significatives, les propriétés théoriques démontrées expérimentalement en laboratoire.
Retrouvez la totalité de cet article dans le PDF téléchargeable
DOI (Digital Object Identifier)
Cet article fait partie de l’offre
Conversion de l'énergie électrique
(275 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
Cet article fait partie de l’offre
Conversion de l'énergie électrique
(275 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Cet article fait partie de l’offre
Conversion de l'énergie électrique
(275 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive