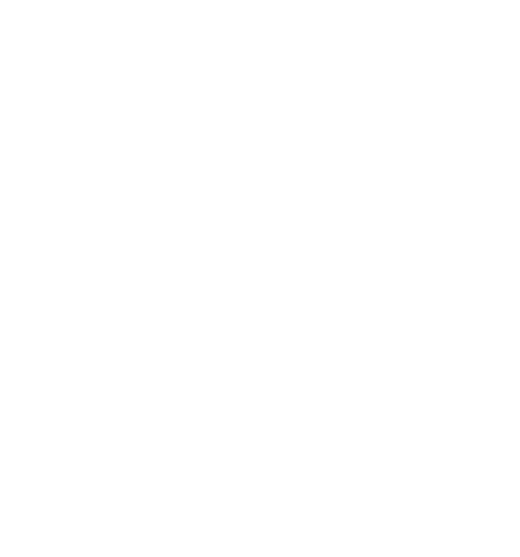- Article de bases documentaires
|- 10 juil. 1984
|- Réf : M65
le coefficient d’expansion soit volumétrique (mesure de volume), soit linéaire (dilatométrie, micrométrie... . Telles sont, par exemple, les méthodes dilatométriques 3.4 , les méthodes de la goutte posée 3... par Campbell CAMPBELL (J.) - * . Méthode dilatométrique ou volumétrique La densité approximative d... ) peut être déterminée par une méthode dilatométrique (méthode micrométrique précise ou interférométrique). Le volume...
Les articles de référence permettent d'initier une étude bibliographique, rafraîchir ses connaissances fondamentales, se documenter en début de projet ou valider ses intuitions en cours d'étude.
- Article de bases documentaires
|- 10 déc. 2023
|- Réf : M90
différentielle à balayage, à la dilatométrie, ainsi qu’à la magnétométrie. Les propriétés d... physico-chimique : analyses thermique, dilatométrique et magnétique, ainsi que les méthodes... dont le diagramme est connu. La technique DSC (calorimétrie différentielle à balayage) et la dilatométrie tiennent... ’ analyse thermique , dilatométrique , magnétique , de résistivité électrique...
Les articles de référence permettent d'initier une étude bibliographique, rafraîchir ses connaissances fondamentales, se documenter en début de projet ou valider ses intuitions en cours d'étude.
- Article de bases documentaires
|- 10 oct. 1996
|- Réf : P3770
(dilatométrie) [20]. Caractérisation des polymères L’analyse relative à la calorimétrie différentielle... est transposable à la dilatométrie. Notons que, à la différence de l’AED, l’ATM donne accès aux variations...
Les articles de référence permettent d'initier une étude bibliographique, rafraîchir ses connaissances fondamentales, se documenter en début de projet ou valider ses intuitions en cours d'étude.