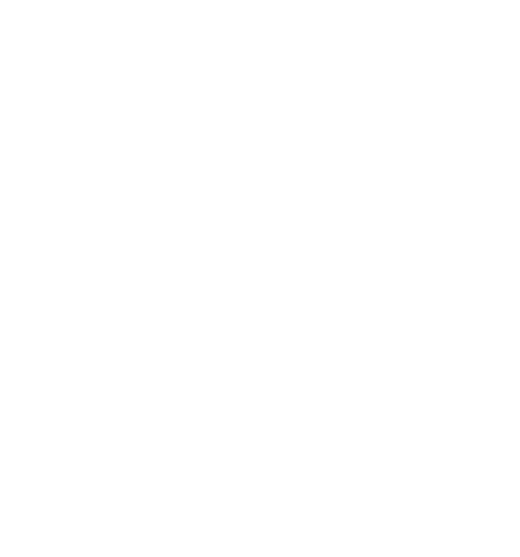- Article de bases documentaires
|- 10 sept. 2024
|- Réf : H4028
Le traitement automatisé de l’information (informatique) s’appuie sur deux concepts de base : le matériel (hardware) et le logiciel (software). Le logiciel, bien qu’objet immatériel, n’existe qu’après avoir été « fabriqué / construit ». Comme toute réalisation humaine, un objet logiciel est soumis à la notion de cycle de vie. C’est-à-dire à enchaîner les étapes suivantes : conception, développement, tests, mise en production, maintenance, retrait. La maîtrise de ces activités est appelée ingénierie du logiciel. Elle fait appel à des méthodes, des bonnes pratiques et des outils. Au niveau international, la capitalisation des connaissances acquises est formalisée dans plusieurs référentiels.
- Article de bases documentaires
|- 10 juin 2025
|- Réf : H4029
Dans le domaine du logiciel, la recherche de la qualité est la préoccupation de tous les acteurs. Le manque de temps, les évolutions technologiques et les contraintes de tous ordres, semblent reléguer les aspirations de qualité au rang des objectifs inaccessibles. Pourtant, la qualité se résume à la satisfaction des exigences de toutes les parties prenantes (utilisateurs, décideurs, organisateurs, acheteurs, chef de projet, concepteurs, développeurs, testeurs, exploitants, etc.). Bien qu’immatériel, le logiciel n’échappe pas à ce principe fondamental. Afin de contribuer à l’amélioration de la qualité, les experts internationaux ont élaboré une plate-forme de textes normatifs. Ce référentiel constitue le point d’appui pour construire la qualité des produits logiciels (progiciels ou développements spécifiques).
- ARTICLE INTERACTIF
|- 10 mars 2024
|- Réf : H8061
Cet article s’intéresse à l'amélioration de la qualité et de la fiabilité du développement de logiciels critiques en avionique, et vise une meilleure intégration plus agile des exigences de certification dans cette démarche. Il propose pour cela un cadre méthodologique, en démontre la conformité aux exigences des normes de certification et suggère un outillage support basé sur des solutions open source et sur étagère pour mettre en œuvre les propositions.