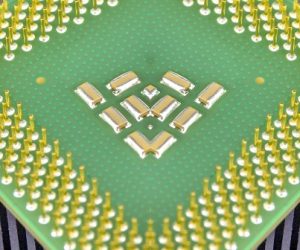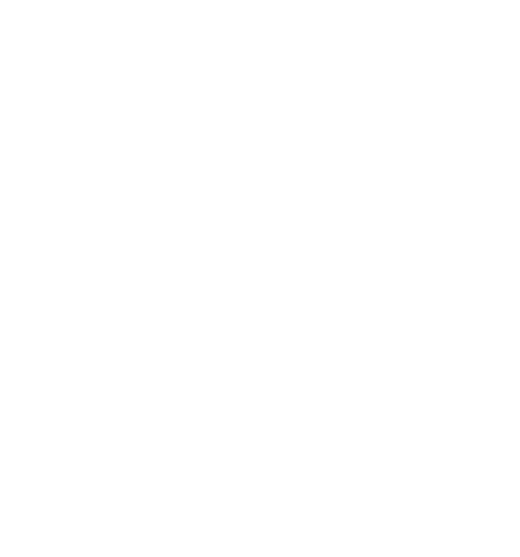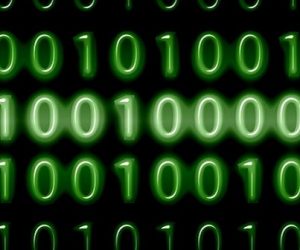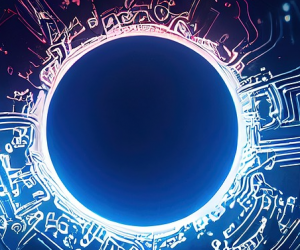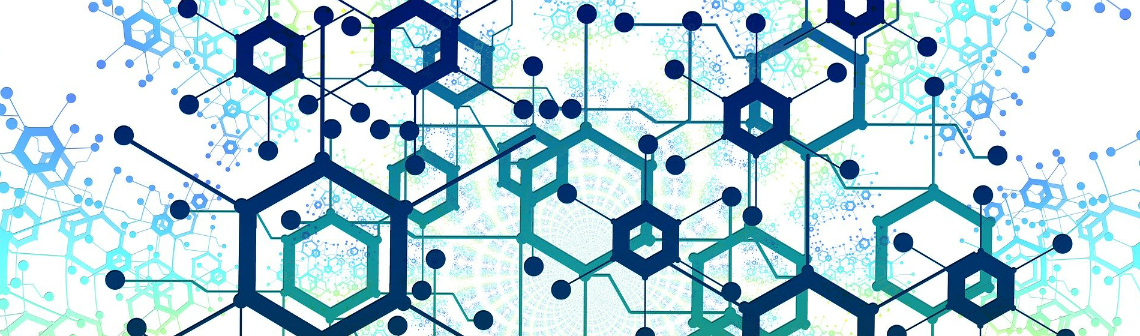- ARTICLE INTERACTIF
|- 10 nov. 2023
|- Réf : AF88
Le terme « logique » est dérivé du grec ancien signifiant à la fois « discours » et « raisonnement ». En tant que domaine interdisciplinaire de la philosophie, de la linguistique, des mathématiques et plus récemment de l’informatique et surtout de l’intelligence artificielle, la logique traite de l’inférence, qui se définit comme une « opération cognitive », forme élémentaire de raisonnement passant de prémisses à une conclusion. Cet article, le premier d’une série de trois, présente des éléments sur les langages et sur les raisonnements, avant d’aborder les systèmes logiques, puis la métalogique. Un glossaire en annexe résume précisément les définitions de nombreuses notions.
- Article de bases documentaires
|- 10 nov. 2023
|- Réf : AF89
Cet article, le deuxième d’une série de trois, traite des logiques classiques qui donneront naissance à la logique mathématique à la fin du XIXe siècle. La logique des propositions est d’abord présentée. Ensuite, est exposée la logique des prédicats qui s’est imposée au tournant du XIXe et du XXe siècle, car admettant un plus grand pouvoir expressif. De nombreux exemples didactiques et applicatifs illustrent les propos. En annexe, sont listées les propriétés des connecteurs logiques et les formes logiques utilisées comme axiomes ou règles d’inférences, ainsi qu’une liste de notations.