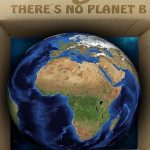Présentation
RÉSUMÉ
En 2015, la production pétrolière offshore s’élevait à 28 millions de barils par jour, soit 33% de la production mondiale. Les fluides de gisement offshore et leur traitement sont semblables à ceux des gisements à terre, mais le milieu marin, sa topographie, le vent, le courant et les vagues dictent le choix de l’architecture de champ et le dimensionnement des ouvrages de production. En 70 ans, plus de 8000 plateformes ont été installées sur le plateau continental et depuis 20 ans des unités flottantes de production, stockage et expédition sont régulièrement mises en service par grande profondeur jusqu’à récemment 3000 m.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleABSTRACT
In 2015 the daily production of oil offshore was 30 million barrels or 33% of global oil production. Offshore wellfluids and their treatment are similar to those onshore, but the offshore bathymetry and geology, wind, current, and waves dictate the choice of field architecture and the design of the production facilities. Over the last 70 years, more than 8000 fixed platforms have been installed on the continental shelf, and in the last 20 years, floating production, storage, and shipment units have been put into deepwater service, recently down to 3000 m.
Auteur(s)
-
Jean-François SAINT-MARCOUX : Consultant, Ingénieur ECL, MSME Caltech, Dr-Ing. UPMC ABYSSOZ, Paris, France
INTRODUCTION
Initialement le pétrole près des côtes était produit à partir d’estacades situées en prolongement direct des champs à terre. Au fur et à mesure du développement des techniques de prospection, il devint possible d’explorer puis d’exploiter des gisements au large (offshore) et de plus en plus profonds. Depuis une dizaine d’années, les nouvelles méthodes d’acquisition et d’analyse des données sismiques en mer permettent d’identifier des réservoirs potentiels non seulement par grande profondeur d’eau mais au-delà, à travers 6 à 8 km de sédiments marins y compris parfois constitués d’épaisses couches de sel. Le progrès concomitant des forages permet l’accès à des profondeurs d’eau de 3,7 km d’eau.
Les débuts de l’offshore remontent à octobre 1947, date à laquelle la compagnie américaine Kerr-McGee a installé la première plateforme dans le golfe du Mexique (Ship Shoal block 32) hors de la vue des côtes par 6,7 m de profondeur à 30 km au large de la Louisiane. À titre de comparaison, en 2015, Total a mis en production le champ de CLOV en Angola par 1 400 m de fond, et Petrobras a mis en production le champ de Guara Sapinhoa au Brésil par 2 400 m de fond. Depuis, Shell a mis en production en septembre 2016 le champ de Stones (Walker Ridge block 508) par 2 900 m de fond à 320 km au large de la Louisiane.
Selon une estimation de l’IFPEN pour 2010, l’offshore représenterait 20 % des réserves mondiales. Entre 2005 et 2015, la production d’huile offshore est restée constante, légèrement inférieure à 30 millions de barils par jour (NYSVEEN, 2015), en dépit d’investissements importants jusqu’en 2014.
En mer comme à terre, la production d’un champ donné de pétrole diminue d’environ 10 % par an si rien n’est fait pour l’assister. Il est nécessaire de faire en permanence des découvertes ne serait-ce que pour simplement maintenir constante la production. Un ralentissement des investissements impacte donc directement la production à moyen terme. Pour les huiles de schiste (aussi appelés hydrocarbures de roche mère), la décroissance annuelle est plus importante, de l’ordre de 40 à 50 %.
Les zones géographiques de production en mer sont très dispersées : principalement la mer du Nord, le golfe du Mexique, le golfe de Guinée, le Brésil, le golfe arabo-persique et l’Extrême-Orient (Australie, Chine, Indonésie, Malaisie) mais aussi de nombreuses autres régions.
Les unités de production de pétrole offshore ont donc rapidement évolué et, avec elles, leurs moyens de fabrication et d’installation.
La problématique de ces unités recouvre :
-
l’importance de la sécurité et de l’environnement, sous l’œil attentif de l’opinion publique ;
-
la dispersion géographique des sites et la difficulté d’y maintenir une logistique et des moyens ;
-
la réduction des coûts particulièrement d’actualité avec la baisse des cours ;
-
la concurrence avec les autres formes de production et en particulier avec la production à terre des hydrocarbures de roche-mère .
Plusieurs aspects de l’offshore ne sont pas traités dans cet article, notamment le forage, la sismique et la géotechnique marine et les activités de construction qui doivent sans cesse s’adapter.
Le lecteur trouvera en fin d’article un glossaire des termes et expressions importants de l’article. Les valeurs en unités américaines, dont l’utilisation reste courante dans le domaine pétrolier, sont données en italique après les valeurs en unités SI.
KEYWORDS
oilfield | platform | FPSO | riser | floowline
DOI (Digital Object Identifier)
CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :
Accueil > Ressources documentaires > Procédés chimie - bio - agro > Bioprocédés et bioproductions > Ressources marines et biotechnologies bleues > Production de pétrole en mer
Cet article fait partie de l’offre
Ressources énergétiques et stockage
(175 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
Cet article fait partie de l’offre
Ressources énergétiques et stockage
(175 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - AIPCN - Paramètres des états de mer (supplément au bulletin n° 52. - Association internationale permanente des congrès de navigation, Bruxelles (1986).
-
(2) - ALLIOT (V.L.-L.) - Lessons learned from the evolution and development of multiple-lines hybrid riser towers for deepwater production applications. - Offshore Technology Conference, Houston (2005).
-
(3) - ANRES (S.D.) - Subsea seawater treatment and injection – Aplication range and approach for design selection (2015-ID137). - DOT. The Woodlands : Deep Offshore Technology International, Houston (2015).
-
(4) - ARNOLD (K.S.) - Surface production operations – Design of oil-handling systems and facilities. - Gulf Publishing, vol. 1, Houston (1986).
-
(5) - ARSEM - Assemblages tubulaires soudés. - Éditions Technip., Paris (1985).
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
ALLSEAS Entrepreneur Offshore International http://allseas.com
COLORADO CENTER FOR ASTRODYNAMIC RESEARCH. Université du Colorado à Boulder, Observations spatiales des océans http://www.ccar.colorado.edu
GULFBASE Données sur le Golfe du Mexique http://gulfbase.org/facts.php
IFPEN IFP Énergies Nouvelles : information sur les hydrocarbures et les différentes sources d’énergie http://www.ifpenergiesnouvelles.fr
INTECSEA Posters téléchargeables révisés annuellement conjointement avec Offshore Magazine http://www.intecsea.com/publications/posters...
Cet article fait partie de l’offre
Ressources énergétiques et stockage
(175 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive