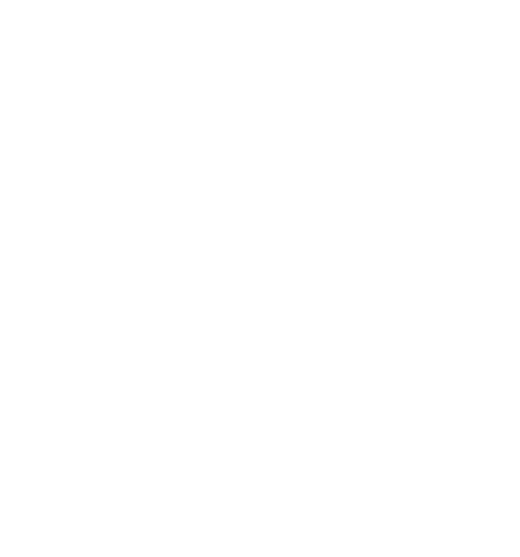1/ Quel est le principal intérêt de l’hydrogène natif ?
Pour l’hydrogène traditionnellement produit à partir de gaz naturel ou d’électrolyse, le coût de production est égal à la somme du coût de la ressource (gaz naturel) et de la transformation (électricité). Les tendances à long terme indiquent que le coût de l’hydrogène va s’approcher soit du coût du gaz naturel, soit de celui de l’électricité. L’hydrogène natif, lui, est disponible gratuitement ; il ne coûte que le forage, ce qui laisse envisager des prix bien plus bas.
2/ Pourquoi les enjeux principaux sont-ils sur la prospection ? 00:56
Il est nécessaire d’étudier la diffusion de l’hydrogène dans les gisements pour déterminer, en faisant le chemin inverse, les lieux propices au forage. Il a donc fallu développer de nouvelles sondes. C’était l’objet du célèbre projet Regalor (projet de recherche sur l’exploitabilité du gaz de charbon en Lorraine). De nouveaux moyens de prospection doivent aussi être mis au point. Par exemple, aujourd’hui, il est possible d’installer des sondes sur des vélos, puis de quadriller le paysage pour repérer les émanations. Sur les zones lointaines, le travail porte sur la manière dont les capteurs vont remonter les données et comment fiabiliser ces dernières. C’est encore le début de l’aventure ! Certaines méthodes de prospection pétrogazière sont transférables, comme les méthodes sismiques pour étudier le sous-sol. Il est cependant nécessaire de développer d’autres connaissances pour caractériser ces gisements, et déterminer où l’on va forer. Pour utiliser une image, il faut trouver où planter une paille pour faire remonter l’hydrogène.
3/ Quels sont les enjeux sur la production ? 2:22
La production semble moins complexe que pour l’exploitation pétrogazière. L’hydrogène diffuse naturellement vers la surface : si le forage est au bon endroit, il semble facile de le collecter. Cependant, il n’y a pas de retour d’expérience sur ce point car les exploitations n’en sont pas encore à ce stade.
Une autre technique d’exploitation consiste à stimuler des roches privées d’oxygène dans certaines configurations géologiques. En amenant de l’eau par forage, un peu comme en géothermie stimulée, on recrée les conditions de la réaction d’oxydoréduction qui produit un dégagement d’hydrogène.
4/ Qu’en est-il du transport ? 3:17
Comme pour le pétrole ou le gaz, les gisements sont éloignés des foyers de consommation. Il va donc falloir une infrastructure intermédiaire. C’est une problématique similaire au transport de l’hydrogène depuis les sites de production par électrolyse (situés dans des lieux à fort ensoleillement et fort gisement éolien, comme en Afrique ou en Amérique du Sud) jusqu’aux sites de consommation sur d’autres continents.
5/ Quels acteurs s’intéressent à ce marché ? 4:00
Il s’agit principalement de sociétés d’exploration junior, canadiennes ou australiennes. Il en existe également en France, comme la société 45-8. Ces sociétés vont chercher de l’hydrogène ainsi que de l’hélium ; ce sont en effet souvent des gisements mixtes. L’hélium représente déjà un marché gigantesque, qui permettrait de financer l’exploration de l’hydrogène, pas encore mature.
6/ L’hydrogène natif peut-il supplanter les filières d’hydrogène de synthèse ? 4:37
L’attention portée à l’hydrogène natif ne doit pas éclipser les autres filières. Au vu des enjeux climatiques, ce serait même une erreur de se focaliser sur cette filière native, au détriment de tous les investissements déjà faits dans les autres filières, comme l’électrolyse. Il faut être prudent ; aujourd’hui, l’hydrogène natif n’est qu’à ses débuts, c’est très spéculatif. On ne peut pas parier dès maintenant sur une exploitation massive de l’hydrogène géologique dans la prochaine décennie. Il y a un véritable risque à délaisser les autres technologies : l’espoir ne peut pas tenir lieu de stratégie.