Que restera-t-il de la promesse présidentielle de « prix planchers » pour améliorer le revenu des agriculteurs ? Une mission parlementaire doit proposer d’ici fin juin une nouvelle révision du cadre des relations commerciales entre agriculteurs, industriels et distributeurs – mais chacun pousse déjà ses pions.
. Pourquoi revoir le système ?
Mi-février, au plus fort de la crise agricole, le gouvernement a confié aux députés de la majorité Anne-Laure Babault et Alexis Izard la mission de formuler, avant l’été, des pistes d’évolution des règles encadrant les négociations entre agriculteurs et industriels d’une part, et industriels et distributeurs d’autre part.
Objectif: éviter qu’un producteur de lait ou de viande ne vende à perte, et faire en sorte que sa rémunération soit à la hauteur du temps passé sur l’exploitation.
C’était précisément l’objectif de la loi Egalim en 2018, soit au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, d’Egalim 2 en 2021 et de la loi Descrozaille (dite Egalim 3) en 2023.
Les blocages d’autoroutes par des agriculteurs impatients de mieux gagner leur vie ont mis sur les rails un Egalim 4.
Lors de sa visite chahutée au Salon de l’agriculture fin février, le chef de l’Etat a dit vouloir « déboucher » sur « des prix planchers qui permettront de protéger le revenu agricole »,
Les partis de gauche ont voulu y voir la reprise d’une de leurs propositions.
Les syndicats agricoles majoritaires (l’alliance FNSEA-JA) et les filières rassemblant les professionnels du lait, de la viande… ont peu goûté la formule présidentielle, y voyant un affront aux lois du commerce dans un marché ouvert, où les productions françaises deviendraient trop chères.
Par la suite, des sources gouvernementales ont expliqué que le président de la République, loin de vouloir « soviétiser » l’économie, avait traduit, en mots simples, l’idée que les acheteurs devaient mieux prendre en compte les indicateurs évaluant ce que coûte, en moyenne, à un agriculteur de produire un kilo de viande bovine ou mille litres de lait.
. La bataille des indicateurs
Selon l’esprit des différentes loi Egalim, industriels et supermarchés ne peuvent pas marchander sur le dos des agriculteurs: en théorie, si le coût de production du lait augmente, l’industriel le paie plus cher, et le supermarché achète le produit final plus cher.
En pratique, cette « sanctuarisation » de la matière première agricole (MPA) est un nouveau champ de bataille : comment objectiver ce coût pour l’industriel, comment le décliner sur une multitude de références (lait chocolaté, yaourt aux fruits rouges…), quel droit de regard du client supermarché ?
Le médiateur des relations commerciales agricoles, Thierry Dahan, a suggéré dans un communiqué une méthodologie pour les contrats: se baser sur un « indicateur de marché pertinent », par exemple les cours du beurre en gros, pour estimer l’évolution du coût de la matière première, plutôt que de s’échiner à vouloir savoir combien l’industriel a réellement payé le lait.
Sa proposition échauffe les esprits.
La déléguée générale de la fédération qui représente les supermarchés (FCD), Layla Rahhou, la dénonce comme étant « totalement pro grands industriels ». Selon elle, si l’industriel peut choisir un indicateur basé sur un cours de marché, il n’y aura alors « ni transparence, ni lien avec la réalité économique des producteurs, ni sanctuarisation de la MPA dans les négociations commerciales… »
Les agriculteurs répètent eux que ce sont les indicateurs de coûts de production qui doivent faire référence.
Ces indicateurs font l’objet d’une négociation, dans chaque filière, entre les producteurs, les industriels et les distributeurs. Ils donnent une estimation de ce qu’il faudrait qu’un agriculteur reçoive pour se verser l’équivalent de deux Smic mensuels. Le calcul intègre ses charges et les subventions qu’il perçoit.
Les industriels s’emploient à instiller le doute sur la qualité de ces indicateurs, pour éviter qu’ils ne deviennent « opposables » comme suggéré par le président de la République.
La Fnil, qui défend les intérêts des transformateurs laitiers hors coopératives (Lactalis, Danone, Savencia, notamment), interroge ainsi la « robustesse » et la « représentativité » de ceux du lait. La fédération insiste sur le fait qu’il peut exister une grande différence de charges, de performance et de rentabilité d’une ferme à l’autre.
cda-myl/abb/dlm
« Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © 2024 Agence France-Presse. »


















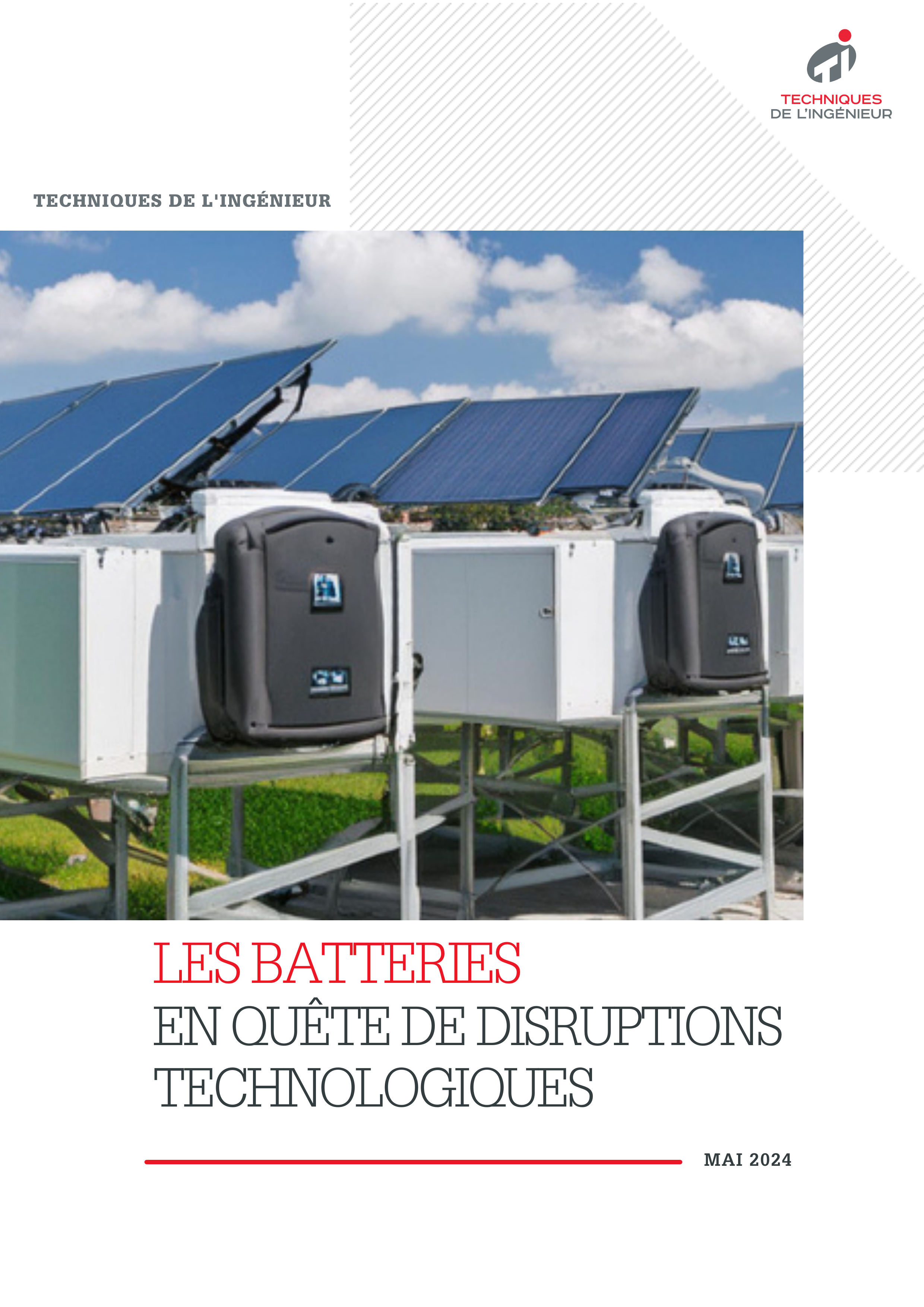

Réagissez à cet article
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.
Inscrivez-vous !
Vous n'avez pas encore de compte ?
CRÉER UN COMPTE