Lancé en 2023, le programme GEAR vise à accélérer le développement de thérapies géniques pour les maladies de la rétine. Il fait pour cela appel à des outils d’intelligence artificielle, utilisés dans le cadre d’une approche dite « rationnelle ».
Acronyme de « Gene therapy Evaluation for the retina using AAV and AI-based Rational design », GEAR est un programme collaboratif mené conjointement par l’Institut de la vision, ADLIN Science et WhiteLab Genomics. Doté d’un budget de 4 millions d’euros, il est soutenu par l’État et la région Île-de-France dans le cadre de l’appel à projets régionalisé i-Demo du plan France 2030, opéré par Bpifrance, et a obtenu la labellisation du pôle de compétitivité Medicen.
Cofondatrice et cheffe de cabinet de WhiteLab Genomics, Lucia Cinque revient pour Techniques de l’Ingénieur sur les objectifs de cet ambitieux programme et les outils mis en œuvre pour y parvenir. Elle nous dévoile également de premiers résultats clés obtenus par le trio de partenaires en mars dernier.
Techniques de l’Ingénieur : Pouvez-vous tout d’abord nous présenter, en quelques mots, les trois acteurs impliqués dans le programme GEAR, et nous en préciser les rôles respectifs ?

Lucia Cinque : L’Institut de la vision – avec lequel nous travaillions déjà sur d’autres projets – est un institut phare en France, et même l’un des plus réputés au monde. Il nous amène à la fois ses connaissances des pathologies rétiniennes, un accès aux échantillons de patients et aux modèles précliniques, ainsi que son expertise dans le développement de traitements innovants.
WhiteLab Genomics, que je représente, est une techbio spécialisée dans l’utilisation de l’IA pour améliorer et accélérer les développements de thérapies géniques. Notre technologie propriétaire d’intelligence artificielle permet d’analyser des données biologiques complexes et de concevoir in silico des candidats thérapeutiques optimisés, réduisant ainsi les délais de développement, les coûts et les risques associés.
ADLIN Science propose quant à elle une plateforme à destination, notamment, de l’industrie pharmaceutique, qui permet de structurer les données utilisées pour entraîner des modèles d’IA. Cette solution collaborative nous permet donc d’intégrer toutes les données à partir desquelles nous travaillons dans le cadre de ce projet.
Quelle est l’approche thérapeutique sur laquelle ce programme « GEAR » se concentre ?

L’Institut de la vision et nous-mêmes nous intéressons tout particulièrement à ce que l’on appelle la médecine génomique, une famille de thérapies avancées qui passent par le transport d’un « matériel » thérapeutique jusqu’à une cellule malade. Pour mener à bien ce type de stratégie, il y a deux approches possibles : on peut soit réaliser directement une injection, dans le cadre d’une approche « in vivo », soit, notamment dans le cadre d’une thérapie cellulaire, prélever au préalable du sang ou des cellules spécifiques, avant de les traiter ex vivo puis de les réinjecter finalement au patient. L’injection contient en quelque sorte un « véhicule » – on parle de vecteur – capable d’amener ses « passagers » – qui sont des éléments thérapeutiques – à destination. À condition bien sûr d’avoir la bonne adresse : il ne s’agit pas de décharger les passagers n’importe où, mais bien de délivrer précisément et exclusivement les séquences thérapeutiques au niveau des cellules malades. Dans le cadre de notre projet, la cible est l’œil, et plus précisément la rétine, un tissu formé notamment de cellules clés pour la vision que l’on appelle les photorécepteurs.
Le laboratoire avec lequel nous travaillons dans le cadre du programme GEAR – dirigé par Deniz Dalkara – est spécialisé dans les maladies oculaires ayant une composante inflammatoire, en particulier la DMLA – qui est la première cause de malvoyance après cinquante ans – et se concentre particulièrement, pour cela, sur l’approche que je décrivais, celle de la médecine génomique. L’œil a en effet pour avantage d’être un organe fermé, dans lequel on peut injecter un matériel thérapeutique sans risque de migration, et donc d’effets indésirables ailleurs dans l’organisme. Pour cette raison, l’œil concentre à lui seul beaucoup d’espoirs en matière de thérapies avancées, et fait donc l’objet de nombreux programmes de recherche comme le nôtre.
Quels sont justement vos principaux objectifs avec ce projet ?
Notre objectif, dans le cadre de ce programme GEAR, est avant tout de parvenir à augmenter la précision d’adressage du matériel thérapeutique dans l’œil. L’objectif sous-jacent est aussi d’optimiser la conception des vecteurs, pour pouvoir diminuer les doses injectées, et donc réduire drastiquement les coûts de ces traitements innovants, qui restent aujourd’hui très élevés.
Notre ambition est aussi de développer des vecteurs haute-performance, qui nous permettent de traiter la rétine dans son intégralité malgré l’injection d’une faible dose de traitement. Aujourd’hui, les injections n’ont qu’un effet localisé, qui ne permet pas au patient de recouvrer une vision normale sur la totalité du champ visuel.
Quel est l’intérêt de faire appel à « l’IA » dans le cadre de ce programme ?
Notre approche basée en grande partie sur l’utilisation d’outils d’IA nous permet d’accélérer fortement la découverte de vecteurs performants, en réalisant rapidement sur ordinateur des criblages qui nous auraient pris beaucoup de temps au laboratoire. Après criblage massif par les algorithmes d’IA, nous obtenons une short list d’une cinquantaine de candidats à haut potentiel, qui donneront, in fine, deux ou trois candidats vecteurs qui pourront être testés sur un modèle animal. Cela va aussi nous permettre, au passage, de réduire drastiquement le recours à l’expérimentation animale, qui est pour l’heure massivement utilisée pour la recherche dans le domaine de la médecine génomique.

Ces vecteurs haute performance nous permettront également à terme de réduire les doses injectées, et donc les coûts des traitements, tout en assurant une distribution des séquences thérapeutiques sur toute la rétine.
L’institut de la vision mène lui aussi, en interne, des travaux faisant appel à des outils d’IA. Ils ont toutefois adopté une stratégie différente de l’approche rationnelle que j’évoquais, qui est celle de l’évolution dirigée. Nous échangeons donc régulièrement des données, via la plateforme d’ADLIN Science, dans l’espoir que la combinaison de ces deux approches nous permette d’améliorer encore plus les performances de ces vecteurs viraux.
L’explicabilité des résultats reste un enjeu majeur, a fortiori dans le domaine de la recherche thérapeutique… Comment avez-vous pris en compte cet aspect ?
La plateforme que nous utilisons est construite autour d’un principe d’explicabilité très forte. Un grand nombre – une vingtaine – des « briques » d’IA qui la constituent sont très largement basées sur des données humaines de haute qualité. Cela nous offre la possibilité de vérifier et de valider les prédictions qui sont faites. Poser un regard critique sur les résultats reste en effet fondamental. On ne peut pas se permettre de baser un programme de recherche thérapeutique uniquement sur une approche computationnelle. Il s’agit d’un grand accélérateur, qui nous permet aussi de réduire les coûts et le recours à l’expérimentation animale, mais qui ne nous dispense pas de passer par un certain nombre d’étapes clés en laboratoire, ne serait-ce que pour des raisons réglementaires.
Pour quelle(s) maladie(s) de l’œil espérez-vous parvenir à développer des traitements, à terme ?
Notre projet ne concerne pas une maladie en particulier, mais vise plutôt à concevoir des « véhicules » qui nous permettront à terme de traiter entre cinquante et soixante maladies oculaires différentes. Obtenir ne serait-ce qu’un ou deux vecteurs hautement performants nous permettrait de lancer une dizaine de programmes de développement de médicaments de thérapie génique, avec l’appui de partenaires pharmaceutiques.
Il existe d’ailleurs déjà un médicament de thérapie génique – le Luxturna – destiné au traitement d’une maladie de l’œil que l’on appelle la dystrophie rétinienne héréditaire. Cette réussite nous permet vraiment d’espérer obtenir des résultats aussi spectaculaires pour d’autres pathologies, grâce aux nombreux projets de recherche en cours comme le nôtre, mais aussi les nombreux candidats-médicaments déjà en phase d’essai clinique.
Vous avez justement annoncé un premier résultat clé en mars dernier. De quoi s’agit-il ?
Comme je l’évoquais, notre objectif est avant tout de développer des vecteurs capables d’atteindre des cellules-cibles bien précises ; autrement dit, des véhicules capables d’aller jusqu’à la bonne adresse. Or, pour cela, il nous fallait au préalable trouver les bonnes « portes d’entrée », c’est-à-dire, biologiquement parlant, des récepteurs de surface, situés, comme leur nom l’indique, à la surface des cellules. L’enjeu, pour nous, était d’identifier des récepteurs les plus spécifiques possible aux cellules de la rétine sensibles à la lumière, en évitant donc les autres types cellulaires. Nous avons pour cela fait tourner des modèles d’IA sur des données issues de séquençage haut débit. Cela nous a permis de trouver quatre récepteurs à très haut potentiel, que l’Institut de la vision a ensuite pu tester sur un modèle pathologique. Ces tests ont notamment permis de confirmer le caractère très spécifique de ces récepteurs vis-à-vis des cellules sensibles à la lumière.
Nous avons alors sélectionné deux de ces quatre récepteurs de surface, sur la base notamment de premiers résultats expérimentaux obtenus par l’Institut de la vision, mais aussi d’un regard critique sur la sécurité de leur utilisation : il faut éviter qu’une fois ciblé, un récepteur puisse engendrer des désordres biologiques dans l’organisme…
Quelles perspectives le franchissement de cette étape clé ouvre-t-il ?
Cela va nous permettre de nous atteler désormais à la conception de vecteurs basés sur un type de virus à ADN dit « adéno-associé », ou AAV. En recourant à nouveau à des outils d’IA, nous allons en modifier certaines séquences, pour le rendre spécifique aux deux récepteurs de surface que nous avons identifiés. Il s’agit d’une approche dite « rationnelle », ou « rational design », qui consiste à identifier tout d’abord une cible, avant de modifier en connaissance de cause certaines séquences génomiques du vecteur pour qu’il puisse s’y lier spécifiquement. Cette stratégie est guidée par l’IA, ou, plus précisément, par les données humaines dont on nourrit nos modèles.
Le travail auquel nous nous consacrons désormais ne concerne plus des données génomiques, mais des données de structures protéiques, et d’interactions moléculaires. Notre objectif est de livrer les parties du vecteur – de petites séquences d’acides aminés qu’on appelle des peptides – modifiées pour qu’elles soient spécifiques des récepteurs que j’évoquais.
Nous transmettrons alors les cinquante meilleurs candidats à l’Institut de la vision, qui se chargera de les tester sur des modèles in vitro – des organoïdes – et des modèles porcins spécifiques à l’étude de maladies rétiniennes, idéalement en début d’année prochaine.
Nous en sommes pour l’heure à un tiers du programme. Nous avons encore un peu moins de deux ans devant nous pour parvenir à développer nos premiers vecteurs.




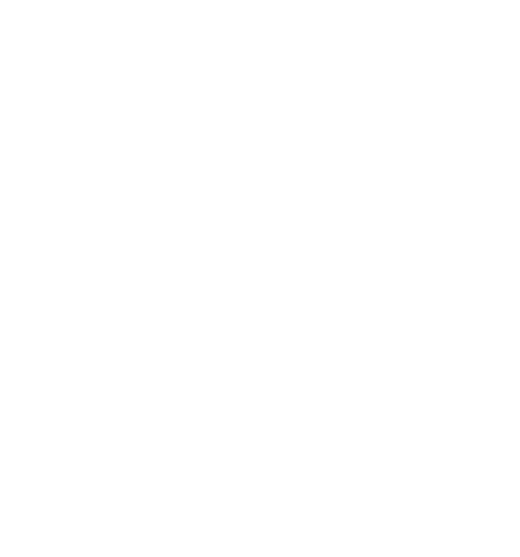
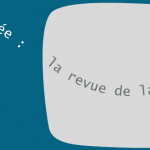















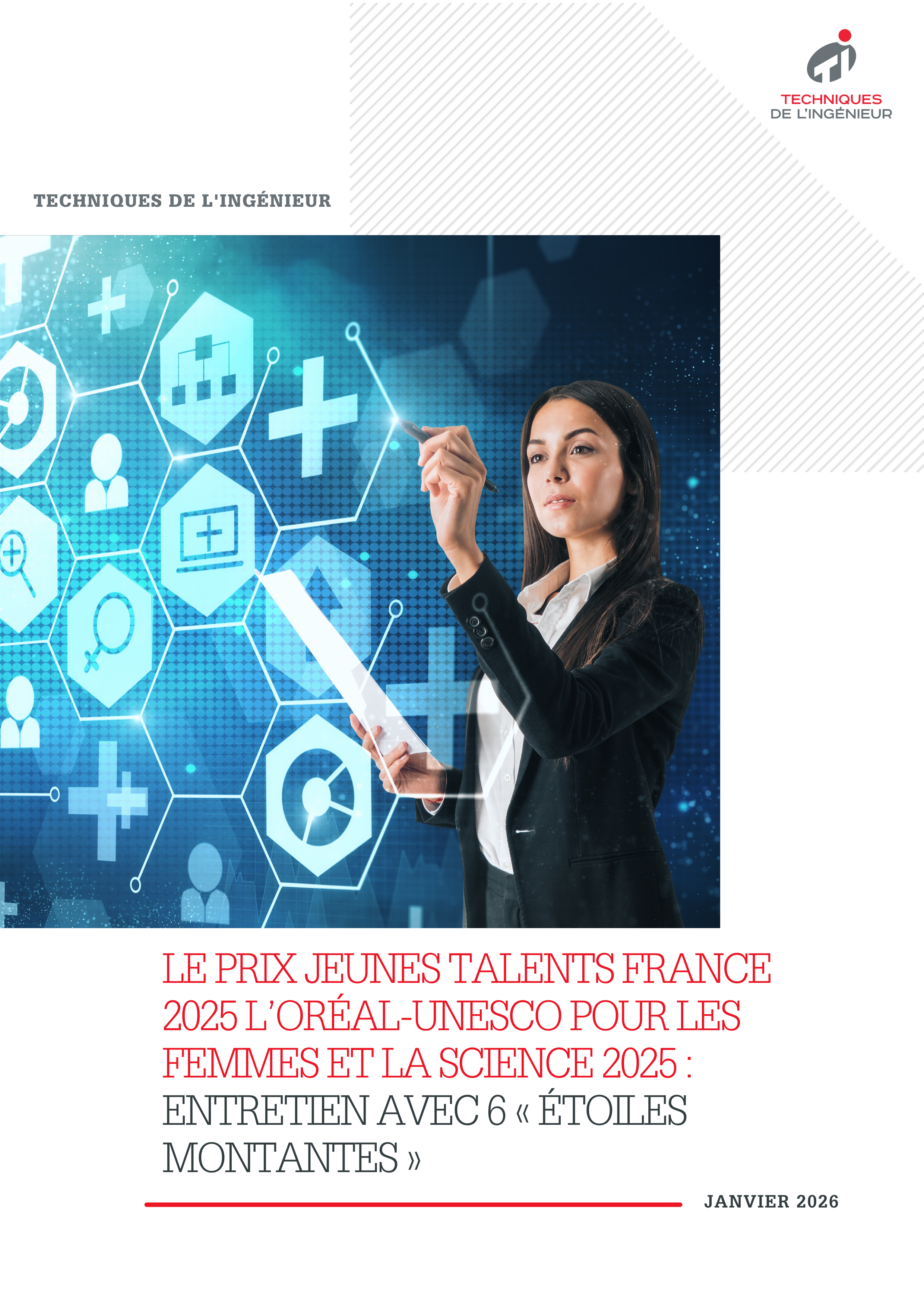

Réagissez à cet article
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.
Inscrivez-vous !
Vous n'avez pas encore de compte ?
CRÉER UN COMPTE