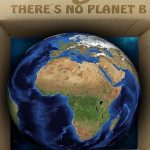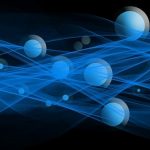Présentation
RÉSUMÉ
Régulièrement, une défaillance éthique - suivie ou non de la disparition de l’organisation - fait la une des médias. De quoi ces défaillances éthiques sont-elles le signe ? De l’incapacité à concevoir des instruments éthiques efficaces ou d’un fait plus profond : dans un monde de complexités, la seule éthique possible provient d’une envie, d’un courage et d’une conscience des conséquences que l’on ne peut trouver qu’en soi.
Une fois trouvée, comment la faire vivre ? Un seul moyen existe : celui par lequel s’incarne déjà chaque activité et fonction de l’organisation : la Parole – écrite ou orale – qui s’échange au quotidien.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleABSTRACT
Corporate failures are very often in the news followed or not by the collapse of the organisation. What do these failures epitomise? That designing proper ethical tools is impossible or that there is a deeper issue to address: in a world of many complexities, the only way to ethics starts with will, courage and awareness of the consequences. All three can only be found in our deepest self.
Once found, how can they be made an everyday reality? Only one way is available, in which every activity and function is already embodied: the way we language ourselves in every spoken and written word on a daily basis.
Auteur(s)
-
Marie-Laure BLANC : Consultant
INTRODUCTION
L’éthique est définie par Paul Ricoeur comme « la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes ». Pour Emmanuel Levinas, elle est « responsabilité à l’égard d’autrui, c’est-à-dire une obligation par laquelle chaque homme doit veiller sur son prochain, sans pouvoir prétendre à la réciprocité ».
Le périmètre recouvert par ces définitions illustre les complexités – qui nous sont propres, sont propres à autrui ou à notre environnement – et que toute démarche éthique doit intégrer.
Comme toute catégorie, l’éthique est menacée par trois écueils :
-
devenir source d’aphorismes creux énonçant quoi faire sans expliquer comment (comme par exemple « placer l’humain au cœur de l’entreprise » ou « diriger par les valeurs ») ;
-
être invoquée pour justifier en réalité les tentatives de domination de l’autre en faisant passer une pratique (de management, communication ou autre) habituelle pour une pratique éthique ;
-
générer une réaction prescriptive a priori évidente (plus de contrôles, de process, d’audit, de chartes) qui permet d’éviter de s’interroger sur l’essentiel.
Le résultat – quant à lui – demeure constant : chaque défaillance éthique (définie ici comme manquement – en conscience ou non – ponctuel ou régulier à des principes universels ou aux règles spécifiques d’une organisation) génère deux questions :
-
comment a-t-on pu en arriver là ? ;
-
pourquoi n’a-t-on rien vu venir ?
Si la défaillance éthique survient – si on en arrive « là » –, c’est parce que la conscience des conséquences de cette défaillance aurait dû être à l’œuvre à certains moments et qu’elle ne l’a pas été. Erreurs de raisonnement, excès de rationalisation et absence de prise en compte d’éléments a priori anodins ont ainsi pu faire leur œuvre. Ce sont donc ces moments que chacun doit être en mesure d’identifier afin d’amorcer une réflexion, puis une démarche éthique, sans attendre que surgisse le grand dilemme éthique qui – jamais – ne se signalera comme tel.
Les récits de résipiscence (reconnaissance de sa faute avec volonté de s’amender) en attestent, qu’ils donnent lieu à des livres : c’est le cas de Jérôme Kerviel (« J’aurais pu passer à côté de ma vie ») ou à des conférences : c’est le cas d’Andrew Fastow, ex Directeur financier d’Enron. Ces récits illustrent qu’omettre – en conscience ou pas – de penser les conséquences de nos choix ouvre la voie à l’effondrement : le nôtre, celui d’autrui et par pente douce celui de notre environnement.
Là, réside un défi trans-disciplines : développer une conscience des conséquences, loin des sermons évidents qui satisfont l’ego de chacun.
Dans cet esprit, voici trois étapes à explorer afin de gérer les complexités de l’organisation avec éthique :
-
identifier les éléments récurrents à l’œuvre dans toute défaillance éthique ;
-
trouver en soi l’envie et le courage d’une éthique universelle – indépendante de toute charte éthique ;
-
traduire sa volonté éthique dans chaque instant du quotidien.
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
Organisation | ethics | Failure | compagnies
DOI (Digital Object Identifier)
CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :
Accueil > Ressources documentaires > Génie industriel > Management industriel > Théorie et management des systèmes complexes > Comment gérer les complexités de l’organisation avec éthique ?
Cet article fait partie de l’offre
Éco-conception et innovation responsable
(139 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
Cet article fait partie de l’offre
Éco-conception et innovation responsable
(139 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - SHOUP (J.R.), STUDER (S.C) - Leveraging chaos : the mysteries of leadership and policy revealed. - Rowan and Littlefield Education (2010).
-
(2) - BAUER (C.) - Better Ethics NOW : How To Avoid The Ethics Disaster You Never Saw Coming (2nd Edition). - Aab-Hill Business Books. Édition du Kindle (2007).
-
(3) - SWARTZ (M.), WATKINS (S.) - Power failure : The inside story of the collapse of Enron. - Crown Business (2003).
-
(4) - ARCHIVES NON OFFICIELLES - * - Code d’éthique d’Enron (2000). http://www.thesmokinggun.com/documents/crime/dont-laugh-enrons-ethics-code Nota : « Smoking gun » signifie preuve accablante.
-
(5) - BALLOT (A.) - L’éthique individuelle, un nouveau défi pour l’entreprise - (Éthique en contextes). L’Harmattan. p. 55. Édition du Kindle (2005).
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
-
ALTRAD
-
EBU (European Broadcasting Union / Union européenne de radio-télévision)
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/About/Governance/Code_Ethics_FR.pdf
-
ETHISPHERE INSTITUTE
-
ETHISPHERE – Résumés, extraits de conférences, webinaires
-
Santa Fe Institute (États-Unis).
Global Ethics Summit 2018. Vidéos accessibles
https://www.globalethicssummit2018.com/videos/
HAUT DE PAGE
...
Cet article fait partie de l’offre
Éco-conception et innovation responsable
(139 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive