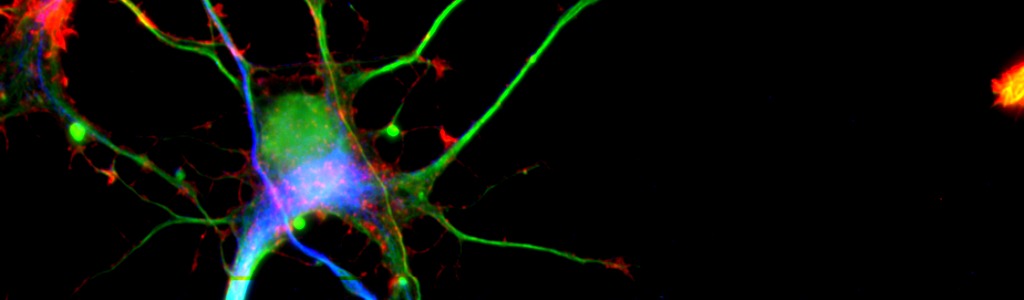Les compétences transférables sont mises en œuvre lors du passage d’un poste à un autre, d’une entreprise à une autre, d’un métier à un autre, d’un secteur à un autre… Frédéric Lainé précise la définition des compétences transférables dans une note du Centre d’analyse stratégique :
« Les compétences transférables sont d’une part les compétences liées à un contexte professionnel particulier mais qui peuvent être utilisées dans un autre métier ou, au sein d’un même métier, dans un contexte professionnel différent, et d’autre part celles généralement acquises en dehors de l’activité professionnelle, mais utiles, voire indispensables, à l’exercice de certains métiers. » .
Elles relèvent principalement de trois registres : l’expertise technique, les compétences transversales et les qualités individuelles. Qu’en est-il de ces compétences transférables dans le cadre d’une mobilité sectorielle vers le monde de l’aéronautique ?
L’expertise technique est le préalable à toute mobilité vers l’aéronautique.
La filière aéronautique est marquée par une exigence de qualité totale, à chaque étape du cycle de production, tant la sûreté des vols et la sécurité des passagers restent la préoccupation majeure. Cet objectif incontournable explique le niveau de qualification élevé des salariés et la haute technicité qui leur est demandée.
Certaines certifications techniques sont à ce titre indispensables dans l’exercice de nombreux métiers de l’aéronautique (travail des métaux, de la mécanique, de l’électronique, de l’informatique, des matériaux…). C’est cette maîtrise technique qui constitue dès lors le premier critère de choix des recruteurs du secteur.
Ainsi, une mobilité sectorielle devra être argumentée avant tout sur les compétences transférables techniques du candidat, plutôt que sur ses compétences transversales ou aptitudes personnelles qui agiront simplement en complément.
« Il faut quand même avoir des compétences de base dans la périphérie de l’aéronautique : connaître soit l’avion, soit un produit dérivé de l’avion, soit les systèmes d’informations embarqués par exemple. » (Consultante, ex-recruteur aéronautique)
Connaître le secteur aéronautique : ses matériaux, son vocabulaire et ses enjeux.
La connaissance approfondie des produits et matériaux utilisés dans l’aéronautique, et des procédés qui leur sont associés (fusion, soudage, thermoformage), constitue inévitablement le premier élément technique à maîtriser.
L’un des défis technologiques les plus importants pour l’aéronautique des vingt prochaines années concerne en effet l’amélioration des matériaux.
La science des matériaux, et les experts en recherche et développement qui lui sont dédiés quel que soit leur secteur, forment dès lors un premier vivier de compétences particulièrement valorisables en aéronautique.
Des spécialistes en amélioration de l’équation poids résistance des équipements (via des matériaux composites ou de nouveaux alliages métalliques au niveau des structures ou des moteurs), sont ainsi très recherchés.
La double compétence sur les matières métal et composite est également précieuse. L’expertise technique repose également sur un vocabulaire spécifique, à apprendre et maîtriser pour comprendre et dialoguer avec tous les interlocuteurs du secteur.
Les cadres ayant connu une mobilité ont ainsi pu évoquer un « choc culturel, avec un vocabulaire spécifique et une codification difficile à assimiler »…
« Pour l’ingénieur, c’est vrai que la différence entre l’aéronautique et l’automobile par exemple n’est pas forcé- ment très grande sur le plan technique. C’est plus une question d’adaptation, de vocabulaire. » (Expert, pôle de compétitivité)
Maîtriser les outils et logiciels de l’avionique
L’avionique, c’est-à-dire l’ensemble des équipements électroniques, électriques et informatiques qui rentrent dans la fabrication et/ou qui aident au pilotage des avions, prend une place de plus en plus importante au sein de la filière aéronautique : cockpit avancé, navigation et gestion du vol, plateformes informatiques et réseaux embarqués, gestion de l’énergie de bord… Un enrichissement des compétences dans ces domaines est attendu.
La maîtrise d’un logiciel ou d’une machine peut alors constituer une clé de passage pour une mobilité sectorielle. La connaissance de ce type d’outil, même très spécifique à un secteur, peut en effet signifier la faculté d’adaptation à un nouveau logiciel de même type dans le secteur aéronautique. De plus, l’évolution actuelle des nouvelles technologies et l’expansion de logiciels, langages et outils informatiques communs favorise les mobilités sectorielles.
Dès lors qu’un cadre maîtrise un outil informatique et/ou un langage de programmation, il devient davantage « employable » par l’aéronautique. Cela concerne par exemple les métiers d’ingénieur électronique de puissance, d’ingénieur calcul, d’ingénieur systèmes aéronautiques, d’opérateur des machines à commande numérique, de programmeur des machines à commande numérique ou d’architecte logiciel aéronautique…
« Tous les logiciels qu’on utilise en modélisation, en simulation ou en gestion sont les mêmes entre le monde automobile et le monde aéronautique. Bon il y a quelques modules spécifiques, car bien sûr on ne dé- passe pas le mur du son en automobile, mais c’est très marginal. À 90 %, ce sont les mêmes codes de calcul. Alors qu’il y a des secteurs, dans le nucléaire par exemple, où ils sont habitués à utiliser d’autres codes de calcul. » (Directeur, établissement de formation)
La dimension technique est également au cœur des attentes des recruteurs pour les profi ls commerciaux. Malgré la dominante commerciale de ces métiers, leur légitimité sur le terrain passera par une reconnaissance de leurs compétences techniques.
Savoir appréhender un univers très normé aux méthodes de production exigeantes
Les besoins en compétences pour les prochaines années concernent en premier lieu la production et son optimisation. Or l’aéronautique présente un contexte et des méthodes de production qui lui sont propres quant aux notions de coût, série et qualité.
A l’inverse de la production agroalimentaire ou, dans une moindre mesure, automobile, la production aéronautique se fait en petite/ moyenne série et la contrainte de coût, bien que réelle, ne peut remettre en question la qualité du produit.
« Le monde de l’aéronautique est quand même resté très « artisanal ». On fabrique dix rafales par an, c’est vraiment une fabrication particulière, avec beaucoup de compagnons, etc. » (Directeur, établissement de formation)
Les cadres de l’aéronautique travaillent dans des entreprises où les normes et les contraintes sont draconiennes (contrôles, références ISO, certifi cation sur les matériaux, les produits…).
Le cadre en projet de mobilité sectorielle vers l’aéronautique devra donc connaître ou apprendre ces normes et contraintes de production. Cependant, ce n’est pas tant la connaissance des normes en elle-même qui est importante (elle est d’ailleurs souvent spécifique au secteur aéronautique et les entreprises pourront investir dans des formations internes), mais l’expérience de travailler dans un environnement fortement normé et contraint.
« Évidemment la production répond à des normes et des process bien spécifiques, mais à partir du moment où vous avez été amené à travailler dans des environnements très normés, peu importe la norme. » (RRH, recruteur aéronautique)
Par ailleurs, les exigences d’un cadre de travail structuré peuvent être fortes. Le secteur de l’aéronautique est fortement hiérarchisé, impacté par une organisation très structurée entre donneurs d’ordres et sous-traitants, et à l’échelle de l’entreprise, par un poids des règles et de la structure de l’organisation, notamment dans les grandes entreprises. Dans ces dernières, les périmètres de responsabilités sont marqués, avec des procédures laissant peu de place aux initiatives individuelles non contrôlées. Ce sera moins le cas dans les PME du secteur.
« Il y a énormément de hiérarchie [dans les grandes entreprises] Parfois, la culture d’entreprise aéronautique avec ses règles strictes plaît moins. » (Consultante, exrecruteur aéronautique)
« C’est vraiment une question de culture. Il y a quand même des procédures, un process assez bien cadré. Pour certains, ça peut être vécu comme une contrainte, parce qu’on n’a pas de marge pour beaucoup de fantaisie et beaucoup d’initiatives. Pour d’autres, c’est rassurant, confortable. Ça peut être bien vécu comme ça peut être mal vécu. » (Directeur, établissement de formation)
Valoriser son expérience de la production en petite et grande série
Côté séries de production, l’avion et ses équipements, comme le ferroviaire dans une moindre mesure, ont cela d’unique qu’ils sont produits en très petite quantité sur un temps long, auquel le cadre en mobilité devra s’adapter. « On connaît bien aussi le secteur ferroviaire. Comme le dit un de mes administrateurs, un train c’est fi nalement un avion qui ne vole pas ! Ce sont à peu près les mêmes séries entre les TGV et les Airbus, c’est très proche. Donc je pense que le passage se fait sans trop de souci. » (Directeur, établissement de formation)
Cependant, l’aéronautique évolue, et passe actuellement des petites séries « artisanales » à la moyenne série, du fait de la demande croissante.
Le secteur a donc tout à apprendre d’autres contextes de production tels que ceux développés au sein du secteur de l’automobile notamment. Les cadres issus d’autres secteurs peuvent donc présenter de vraies valeurs ajoutées aux yeux des recruteurs de l’aéronautique, particulièrement sensibles à ces nouveaux enjeux en interne.
Connaître et travailler dans un environnement de production industrielle en série devient en effet une compétence particulièrement recherchée, qui peut faciliter une mobilité sectorielle vers l’aéronautique.
« Ce n’est pas un critère discriminant de ne pas venir de l’aéronautique, et dans le cas précis de l’automobile, c’est même très valorisant pour nous. Parce que les personnes qui viennent de l’automobile ont en général connu des cycles de production beaucoup plus courts, et donc d’autres types de contraintes temporelles, avec une certaine forme de pression, de rapidité d’exécution, qui pour nous sont très intéressantes, même si on sera forcément dans des cycles de production beaucoup plus longs. » (RRH, recruteur aéronautique)
Au-delà de l’expertise technique du secteur, c’est bien la capacité à organiser des chaînes de production et à les optimiser qui est ici recherchée. Les spécialistes de l’industrialisation et des méthodes, les techniciens de la qualité et de la logistique, les experts du lean management sont tous concernés par cette diversification des recrutements à venir.
« L’aéronautique est en train de passer de petites séries à des moyennes séries. Donc ils sont intéressés par le fait que l’automobile leur passe un petit peu des savoir-faire qu’eux n’ont pas… » (Expert, pôle de compétitivité)
Valoriser une expérience du management d’équipe et de projets
Dans une filière qui travaille beaucoup en mode projet, dans une logique système, et sur des réalisations d’une grande complexité, les ingénieurs et techniciens supérieurs sont amenés à élargir leurs compétences relationnelles, en particulier pour occuper des fonctions de management.
Cette capacité à encadrer et à s’affirmer face à une équipe n’est pas spécifique au secteur d’activité dans lequel elle est exercée, et peut donc constituer un levier de mobilité vers l’aéronautique. Elle est d’autant plus attendue que certaines entreprises du secteur souhaitent renouveler leurs méthodes de management (par exemple les formations proposées en interne par Airbus à travers leur Leadership University). Cependant, même si le management d’équipe et de projets constitue une passerelle facilitant les mobilités sectorielles, il pourra rarement être le seul vecteur de transition vers l’aéronautique.
« Ils nous ont demandé de préparer les ingénieurs diplômés avec 10-15 ans d’expérience à la gestion de la complexité des grands projets. C’est vrai qu’on les sensibilise un petit peu au niveau de la formation initiale, mais il y a besoin de plus les muscler, parce que c’est très compliqué d’être chef de projet avec 300 ou 400 ingénieurs sous ses ordres, dans différents pays etc. » (Directeur, établissement de formation)
« Avec la digitalisation, on passe aux modèles californiens de Google, etc. Ils cherchent des gens qui justement ne sont pas clonés ‘aéronautique’, qui apportent cette façon différente de travailler que souhaitent les directions aujourd’hui. Des gens très leaders, très charismatiques, qui vont insuffler le changement. » (Consultante, ex-recruteur aéronautique)
Maîtriser les langues afin d’échanger dans un environnement de travail international
L’industrie aéronautique et spatiale est fortement internationalisée. De plus en plus d’entreprises, PME comme grands groupes, sont ainsi amenées à travailler à l’international parce qu’elles y sont contraintes par le marché ou parce que ce sont des filiales de groupes internationaux. Par ailleurs, la majorité des productions aéronautiques concernent aujourd’hui des projets transnationaux. De ce fait, ils se déroulent dans un environnement multiculturel et polyglotte peu présent dans les autres secteurs de l’industrie française.
La maîtrise d’une langue étrangère est une compétence transversale assez facilement transférable et souvent indispensable pour les cadres de l’aéronautique, quel que soit leur niveau. En dépit de la suprématie de la langue anglaise dans les conventions officielles, le choix et le contrôle des composants requièrent des compétences linguistiques dans les services commerciaux et des achats pour débattre et valider les options techniques dans la langue du vendeur.
Pour cela, les entreprises du secteur ont besoin de recruter des ingénieurs ou des techniciens supérieurs capables de dialoguer dans l’anglo-allemand technique, l’anglo-espagnol technique, l’anglo-italien, etc. Le multilinguisme, qualité rare en France, devient une compétence de plus en plus recherchée parmi les ingénieurs de la fi lière européenne dont l’excellence repose sur des contributions croisées entre la plupart des pays de l’UE.
« Chez Dassault, chez Airbus, on cherche de plus en plus des gens qui sont capables de négocier des prix, de parler des langues étrangères… Dans l’aéronautique vous avez l’obligation, quel que soit votre niveau, ouvrier, technicien ou ingénieur, d’avoir un minimum d’anglais. Ça, c’est un peu la différence par rapport à l’automobile. Je me rappelle avoir rencontré des gens de l’automobile avec qui j’avais insisté beaucoup sur la langue anglaise. Ils ont dit « Il faudra qu’on s’y mette. ». La langue est un frein. » (Expert, pôle de compétitivité)
Source : Apec




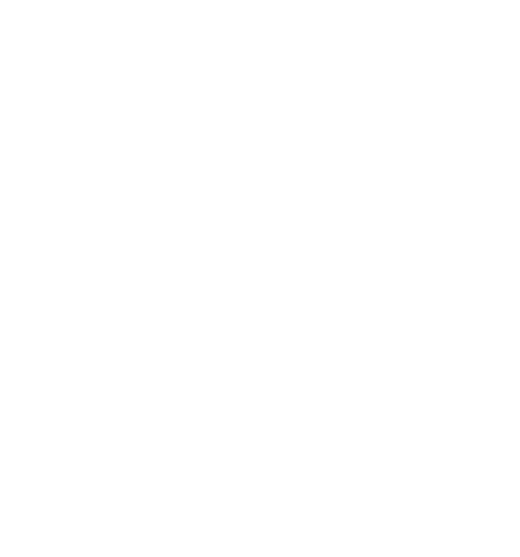




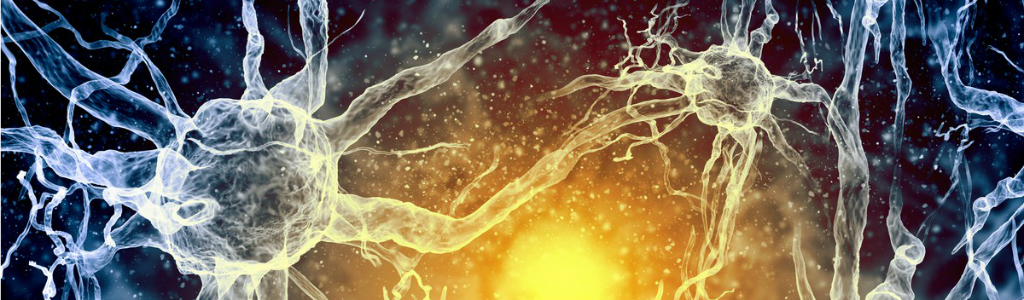
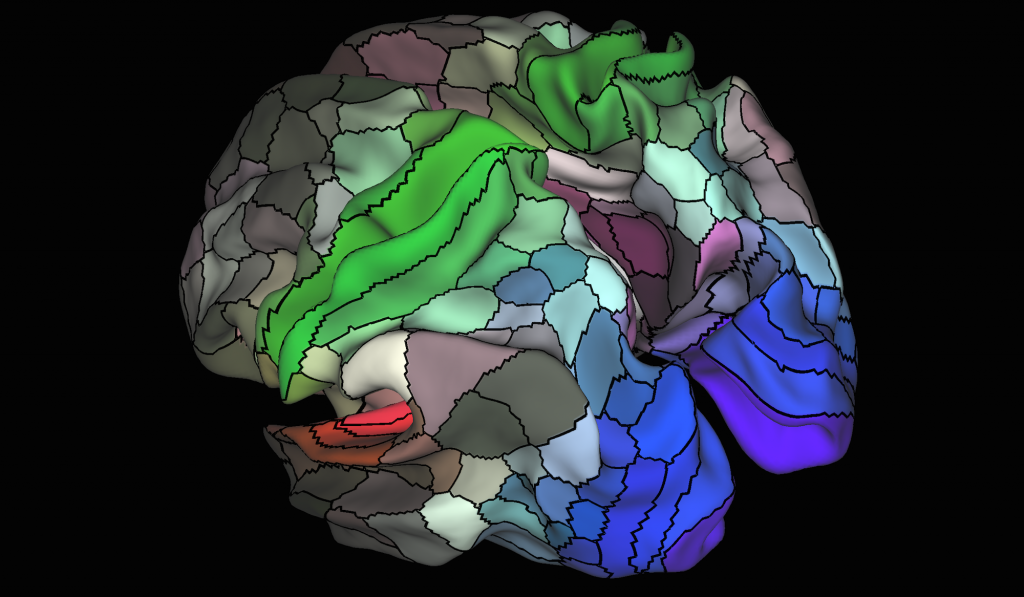
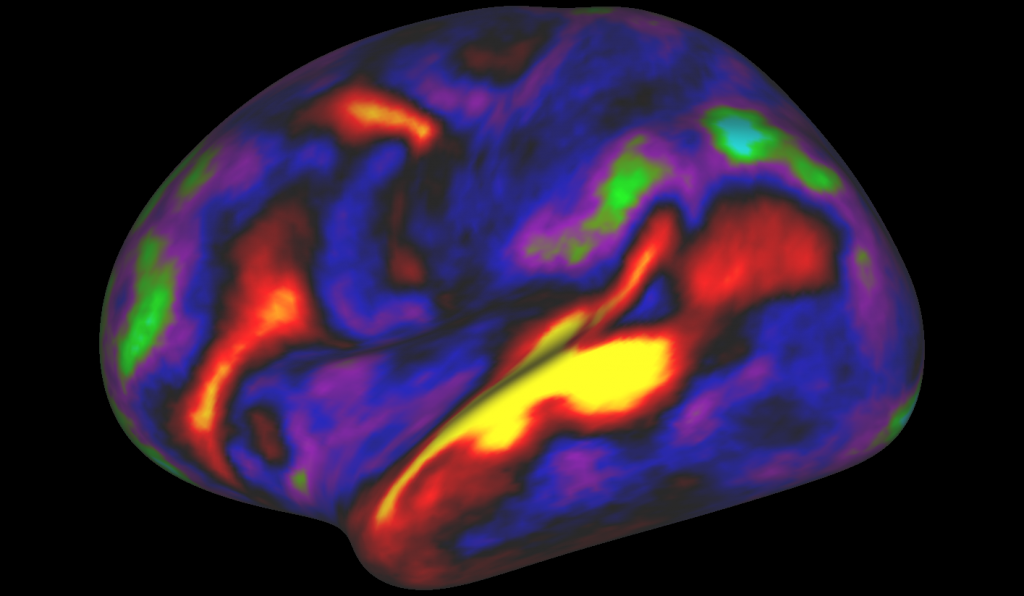





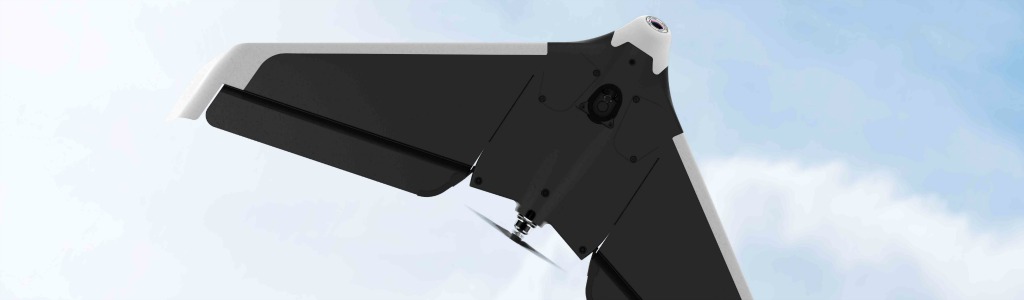


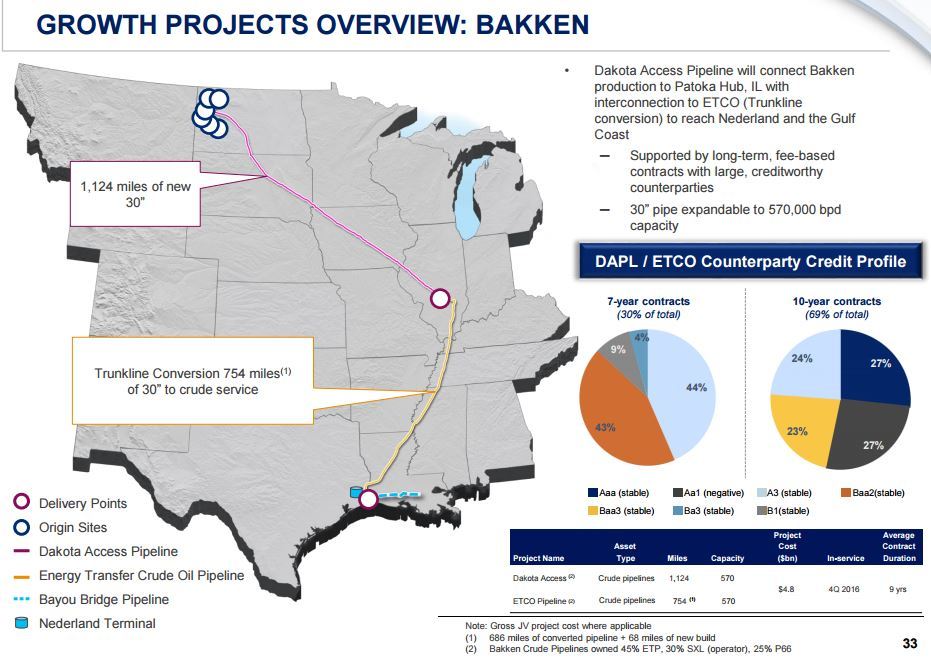












 Snapchat vs Google
Snapchat vs Google