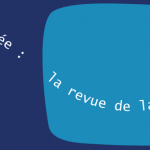Présentation
RÉSUMÉ
A l’échelle globale, de multiples projets d’agriculture (péri)urbaine (AU) illustrent une dynamique sociale, environnementale et économique bien ancrée. Ces projets d’AU apportent des réponses concrètes aux défis des villes durables. Cependant, les zones urbaines sont caractérisées par de fortes densités de populations et activités anthropiques ; des conflits d’usage pour les espaces et des pollutions sont fréquemment observés. Cet article traite de la dynamique impulsée par les AU à l’échelle globale et en France pour promouvoir des transitions écologiques sectorielles et multiacteurs sur les thèmes de l’alimentation durable, la santé environnementale et l’éducation inclusive.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleABSTRACT
On a global scale, multiple (peri)urban (UA) agriculture projects illustrate a well-established social, environmental and economic dynamic. These UA projects provide tangible responses to the challenges of sustainable cities. However, urban areas are characterized by high population densities and anthropogenic activities; conflicts for spaces and pollutions are therefore frequently observed. This article deals with the dynamics driven by UAs on a global scale and in France to promote multi-stakeholder and sectoral ecological transitions on the themes of sustainable food, environmental health and inclusive education.
Auteur(s)
-
Camille DUMAT : PR Toulouse INP-ENSAT - Laboratoire CERTOP, association Réseau-Agriville, Toulouse, France
INTRODUCTION
Plus de 50 % de la population mondiale vit en zone (péri)urbaine et cette tendance s’accentue. C’est pourquoi de nombreux projets d’agriculture (péri)urbaine (AU) se développent sous l’impulsion des citoyens qui souhaitent améliorer leur cadre de vie. Proposer des projets d’AU qui ont du sens, participer aux décisions, agir et interagir avec son environnement permet en effet de s’y sentir mieux intégré. Des projets d’AU très variés existent, car ils sont construits en fonction des spécificités territoriales et des dynamiques sociales associées. En conséquence, il n’y a pas une définition de l’AU. On parlera souvent au pluriel des « AU » pour souligner le vaste panel de projets : cultures en pleine terre, hors-sol ou hydroponie, sols reconstitués avec des techniques proches de la permaculture, l’AU peut être low-tech basée sur la récupération de matériaux ou high-tech en recourant aux dernières technologies et à la robotisation. Pour l’agriculture rurale, de nombreuses variantes existent selon la taille de l’exploitation, le type de production, le modèle économique et les pratiques : agriculture conventionnelle, raisonnée, biologique ou agroécologie. Pour les AU, encore plus de variantes existent, car les projets peuvent être professionnels ou amateurs, des formes hydrides ou mixtes (production, zone récréative et/ou de formation) des formes plus technologiques pour résoudre les problèmes de place et renforcer l’attractivité du site pour le grand public : fermes verticales, démonstrateurs d’aquaponie, containers pour des cultures de champignons sur des supports issus de déchets urbains.
Ces projets d’AU apportent des solutions concrètes aux défis des villes durables, en rendant des services complémentaires tels que la production locale de denrées alimentaires, la valorisation des déchets, le renforcement des liens sociaux ou l’éducation à l’environnement. Les citoyens sont ainsi reconnectés à l’environnement, développent une consommation plus écologique et sont davantage motivés pour se former et participer aux débats citoyens. Ces projets d’AU prennent de l’ampleur (microfermes urbaines, tours agricoles ou carrément quartiers écologiques), avec la participation active des entreprises et élus car ils apportent des réponses concrètes aux défis des villes durables du futur. Cependant, les zones (péri)urbaines sont caractérisées par de fortes densités de populations et activités anthropiques : des conflits d’usage des espaces et des pollutions sont en conséquence fréquemment observés. Pour dépasser ces contraintes spécifiques aux zones urbaines et construire les solutions du bien vivre ensemble, les gestionnaires des villes développent des stratégies telles que la création de zones de maraîchage professionnelles hybrides multifonctions, l’organisation de concertations citoyennes (projets d’alimentation territoriaux, d’urbanisme, habitation, climat, etc.), le soutien aux jardins collectifs urbains ou aux marchés de plein vent regroupant des producteurs locaux. Les projets d’AU apparaissent prometteurs comme vecteurs de concertations interacteurs qui participent aux dynamiques de gestion des espaces. Ils impliquent en effet de coconstruire une convergence éclairée, suite à d’éventuels ajustements, entre les intérêts des différents acteurs motivés (citoyens, élus, entreprises) qui s’appuient sur les compétences scientifiques inter/transdisciplinaires d’experts urbanistes, agronomes, sociologues, etc.
Plusieurs des grands défis contemporains sont en effet directement liés aux systèmes agricoles et alimentaires : l’emploi (50 % du travail mondial se trouve dans le système alimentaire), la santé, le climat (30 % des émissions mondiales de GES émanent du système alimentaire), la gestion des ressources naturelles (75 % des eaux douces sont consommées dans ou par le système alimentaire mondial, principalement par les activités agricoles). La construction d’une vision partagée et la mise en œuvre de collaborations peut décupler les capacités de lutte contre les externalités négatives d’un système alimentaire mondialisé et renforcer la capacité d’engagement des métropoles et grandes villes sur les chemins de la transition écologique.
Cet article a pour objectif d’apporter un éclairage sociotechnique sur la dynamique impulsée par les AU pour promouvoir des transitions écologiques sectorielles et multiacteurs, sous le prisme de : l’alimentation durable, la santé environnementale, l’éducation inclusive et leurs interactions. Après une revue de l’AU mondiale, un comparatif de plusieurs grandes villes françaises est proposé. Finalement, sont discutés dans un esprit d’amélioration continue les avantages et limites de l’AU pour le continuum « formation-recherche-développement » et l’articulation entre savoirs et savoir-faire.
MOTS-CLÉS
Alimentation durable Agriculture urbaine (AU) Transition écologique Santé environnementale Education inclusive Interdisciplinarité Design territorial
KEYWORDS
Sustainable food | Urban Agriculture (UA) | Ecological transition | Environmental health | Inclusive education | Interdisciplinarity | Territorial design
DOI (Digital Object Identifier)
CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :
Accueil > Ressources documentaires > Innovation > Smart city - Ville intelligente et durable > Construire et concevoir la ville durable > Rôles de l’agriculture urbaine dans les transitions écologiques
Cet article fait partie de l’offre
Génie écologique
(48 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
Cet article fait partie de l’offre
Génie écologique
(48 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - INSEE - * - . – https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-31555.
-
(2) - United Nations Department of Economic and Social Affairs - Population Division. - World Urbanization Prospects (2014).
-
(3) - * - Conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable « Habitat III », Quito (2016).
-
(4) - BÉCHET (B.) et al - Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : déterminants, impacts et leviers d’action, synthèse du rapport d’expertise scientifique collective. - Ifsttar-Inra (France), 127 p. (2017).
-
(5) - GOUIN (S.) - En France et dans le monde, la ruée vers les terres s’accélère. - Basta. https://www.bastamag.net/En-France-et-dans-le-monde-la-ruee-vers-la-terre-agricole-s-accelere (2017).
-
...
ANNEXES
Fermes d’avenir :
Concevoir des écosystèmes humains équilibrés, c’est la définition de la permaculture. Cela consiste à envisager des dynamiques locales vertueuses, conjuguant viabilité économique, préservation voire restauration du capital naturel, autonomie et résilience énergétique, création de liens et de valeurs, et respect des femmes et hommes du territoire.
France urbaine :
Avec plus de 2 000 communes dans lesquelles réside près de la moitié de la population française, France urbaine représente toute la diversité urbaine. France urbaine compte en effet 104 membres de toutes tendances politiques dont 51 villes, 22 métropoles, 15 communautés d’agglomérations, 11 communautés urbaines et 5 établissements publics territoriaux franciliens. Elle est présidée par Jean-Luc-Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole.
MOOC-TEAM :
https://reseau-agriville.com/mooc-education-inclusive-environnement/
Ce MOOC interdisciplinaire grand public fera la part belle à partir de septembre 2019 aux métaux lourds : d’où viennent-ils ? Quels sont les problèmes qu’ils provoquent ? Comment sont-ils perçus par la population ? Comment les analyser et agir ? Quatre semaines de cours peaufinés par une équipe de six ingénieurs, chercheurs et enseignants-chercheurs qui permettront aux curieux de bien comprendre tous les processus des métaux lourds dans l’environnement....
Cet article fait partie de l’offre
Génie écologique
(48 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive