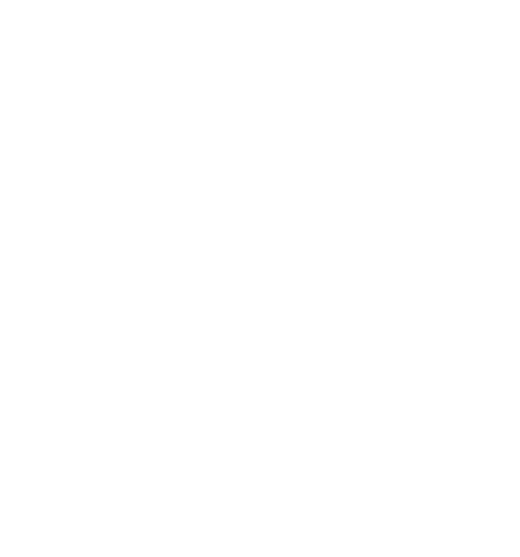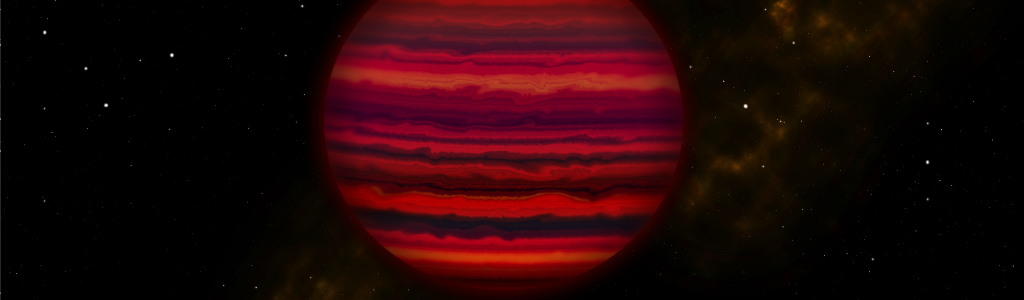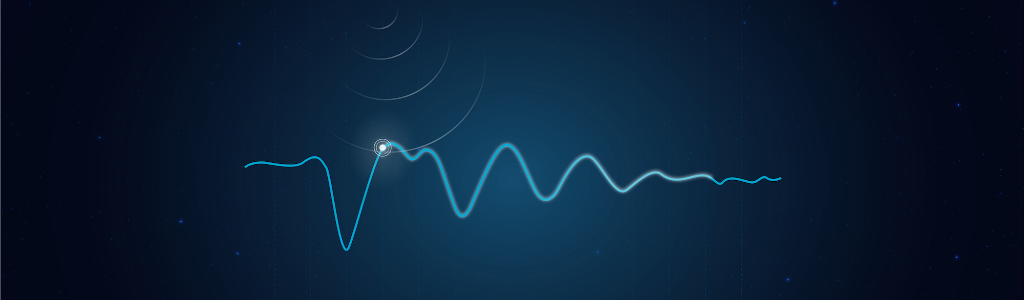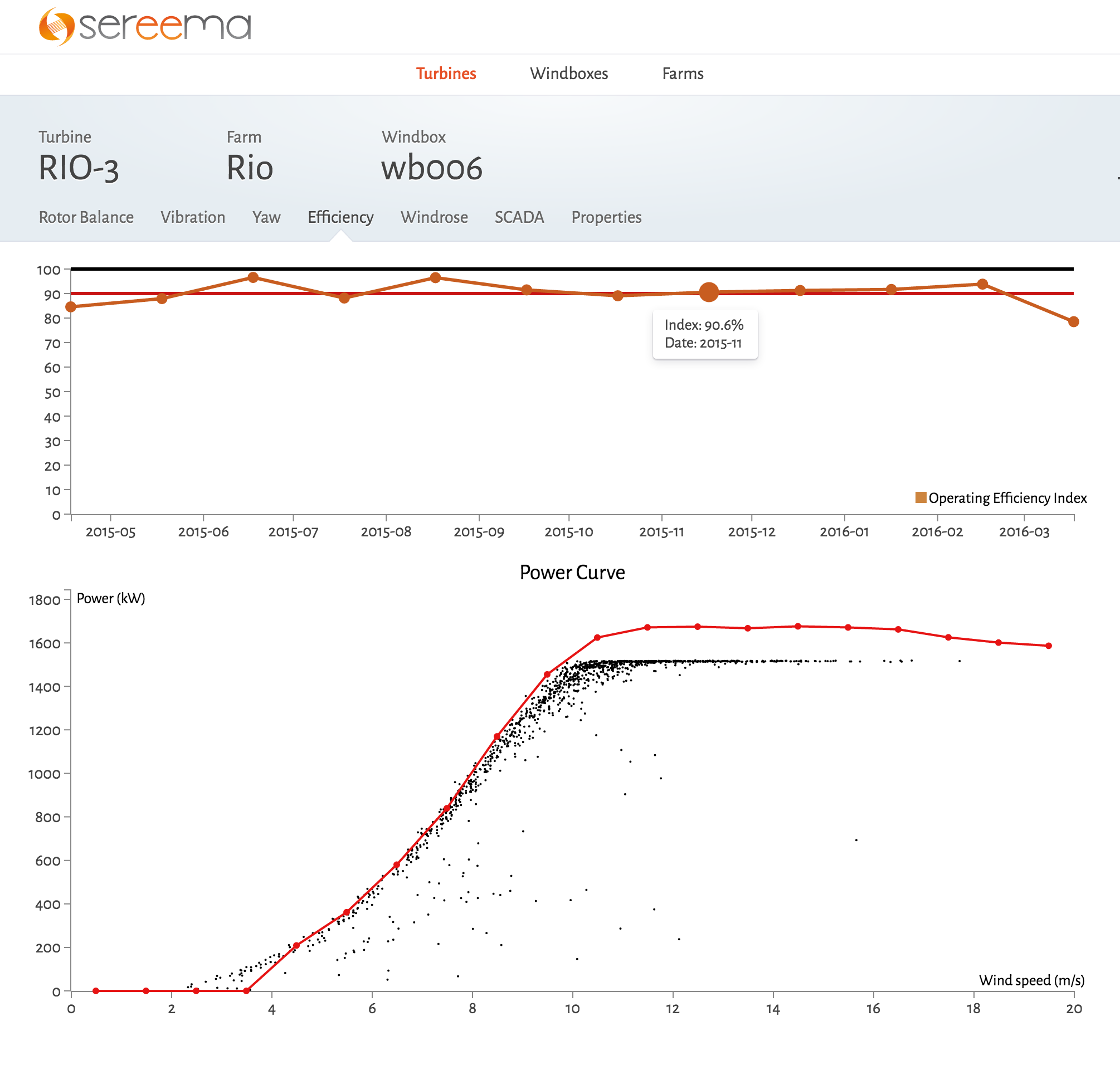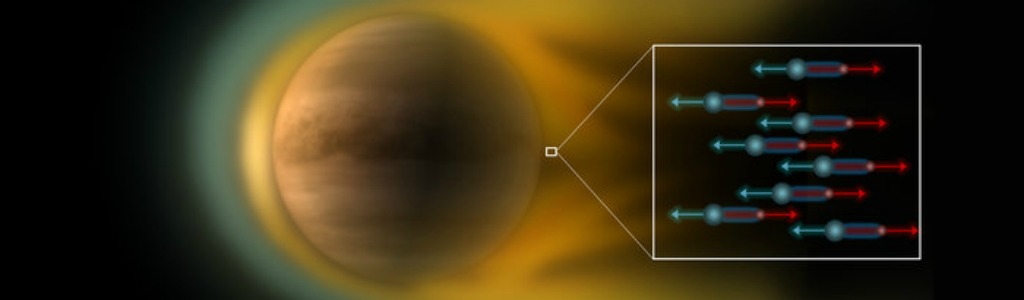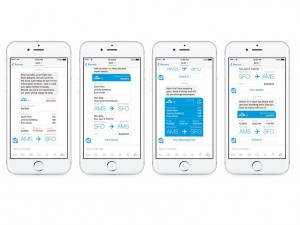Pour la direction d’EDF, le temps de la concertation est passé. Le projet Hinkley Point C, qui prévoit la construction de deux EPR (1 700 MW) dans le sud de l’Angleterre pour 18 milliards de livres (21,6 milliards d’euros), doit être définitivement validé afin de passer aux étapes suivantes. EDF justifie sa décision par le fait que « ce projet a fait l’objet depuis 2013 d’un large partage d’informations avec les salariés et leurs représentants, illustrant ainsi l’attachement de l’entreprise à mettre en œuvre une démarche de dialogue social de qualité ». Une version contestée par l’intersyndicale de l’entreprise qui ne compte pas laisser faire.
Référé
En rendant « copie blanche » début juillet, le Comité central d’entreprise (CCE) d’EDF dénonçait le « délai extrêmement court et inadapté à un projet d’une telle ampleur » et l’absence d’informations précises. Le CCE a fait un pas de plus en lançant une procédure en référé d’heure à heure pour le retrait du dossier Hinkley Point. Cette démarche permet d’obtenir de la Justice une décision provisoire dans un délai de 48h à quelques jours. Le CCE espère ainsi obtenir la suspension de tous les effets des délibérations qui seraient prises par le conseil. Une décision qui s’explique par la volonté de passage en force de la direction, le manque d’informations transmis aux représentants des employés et l’audience fixée au 22 septembre prochain, selon le CCE. Sur le fond du dossier, il ne cache pas ses craintes : « Prétendre qu’une décision précipitée sur Hinkley Point va sauver la filière nucléaire est une vaste escroquerie intellectuelle et une faute politique. Au moment où la filière nucléaire française se retrouve fragilisée par des années d’absence de stratégie industrielle de l’Etat, cette décision risque en effet d’avoir des conséquences dramatiques sur cette filière industrielle, les investissements d’EDF sur le territoire national et par conséquent l’emploi en France. Alors que la priorité de la filière est le grand carénage dont le financement est mis en risque par le montage financier d’Hinkley Point, cette décision est totalement incompréhensible ».
Enquête de l’AMF et Brexit
Ce nouveau rebondissement fait suite à une autre mauvaise nouvelle pour EDF : la perquisition de son siège par des agents de l’Autorité des marchés financiers (AMF) la semaine dernière. « Trois personnes de l’AMF se sont présentées chez EDF et ont donc démarré un processus d’enquête portant sur l’information financière qu’EDF a donnée au marché depuis 2013 » concernant les projets de Grand Carénage et de Hinkley Point C, a indiqué l’AFP.
Le Brexit complique enfin un peu plus encore une situation qui n’était déjà guère à l’avantage des promoteurs du projet. Malgré des annonces rassurantes, les conséquences économiques et financières de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sont encore impossibles à prévoir, de sorte que tout investissement massif est sujet à davantage d’incertitudes. L’Etat, actionnaire à 85% d’EDF, soutient sans réserve le projet qui doit conforter la place d’EDF comme premier électricien au Royaume-Uni en volume, et valoriser le réacteur français de nouvelle génération.
Romain Chicheportiche